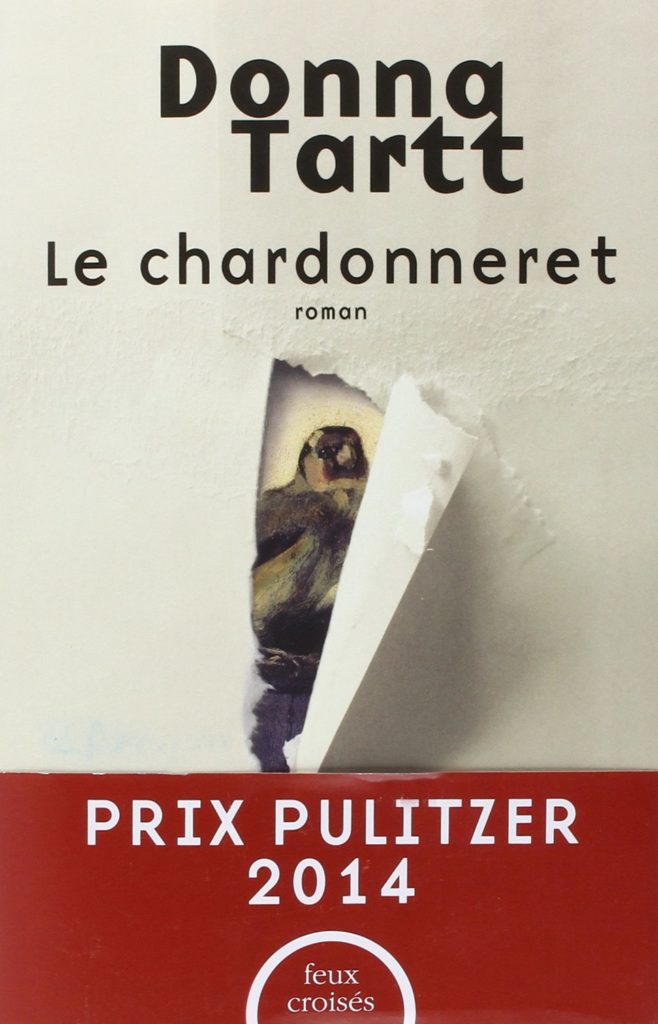L’avion avait déjà entamé sa descente vers Washington quand le pilote de South African Airways nous annonça qu’en raison des chutes de neige, notre vol serait détourné vers l’aéroport JFK de New York. J’avais quitté le Lesotho et l’Afrique du Sud sous le soleil, et une des plus grosses tempêtes de neige que la région de la capitale américaine ait connue ces dernières années m’empêchait de revenir auprès de ma famille après plus de seize heures de vol. Une fois n’est pas coutume, New York, plus au nord, était épargné par le blizzard. Bloqué pour 24 heures dans la ville dans le froid de janvier, je décidai, après avoir déposé mes bagages à l’hôtel, de prendre un taxi pour passer l’après-midi au « MET », le Metropolitan Museum of Art, qui dresse sa large silhouette sur les bords de Central Park.
Le MET joue un rôle important dans le superbe et captivant roman « Le chardonneret (The Goldfinch) » de Donna Tartt que j’ai déjà évoqué dans un article précédent. « Le Chardonneret » est un tableau du XVIIème siècle du peintre hollandais Carel Fabritius, une des rares pièces conservées de cet élève de Rembrandt qui périt avec plusieurs de ses tableaux dans l’explosion de la poudrière de Delft. C’est une magnifique miniature représentant l’oiseau éponyme que l’on peut admirer à la Mauritshuis de La Haye. Mais dans le roman de Dona Tartt, le tableau est prêté au MET pour une exposition temporaire que visite Theo Decker, un jeune adolescent de 13 ans, en compagnie de sa mère. Theo est attiré par une fille aux cheveux roux et perd de vue sa maman quand une explosion retentit dans le musée. Bien que choqué, il est indemne. Alors qu’il cherche à sortir des décombres, il est apostrophé par un vieil homme en train de mourir qui lui confie une bague avec un message et lui montre le petit tableau de Fabritius. Theo croit comprendre qu’il lui demande de sauver le tableau. Il s’en empare, parvient à sortir du musée par une issue de secours et rentre chez lui pour attendre sa mère. Elle ne reviendra pas, tuée dans l’attentat terroriste qui a détruit une partie du MET.
Son père étant aux abonnés absents depuis des années, Theo se retrouve de facto orphelin à 13 ans. Pour ne pas être pris en charge par les services sociaux de la ville, il va vivre dans la famille d’un ami d’école. Il se lie aussi d’amitié avec le vieil antiquaire new-yorkais qui était le partenaire de l’homme qui lui avait confié une bague lors de l’explosion. Deux ans plus tard, son père, un joueur professionnel refait surface et l’emmène à Las Vegas. Theo emporte avec lui « Le Chardonneret » qu’il avait toujours soigneusement caché. Le roman suit Theo, et son tableau, à Vegas, puis de retour à Manhattan et enfin à Amsterdam, alors qu’il passe de l’adolescence au monde adulte. Theo se rend compte que le tableau est recherché par la police. Il ne sait plus trop qu’en faire. Des criminels veulent le faire chanter. Il devient lui-même un faussaire. Mais recroise Pippa, la fille aux cheveux roux qui a aussi survécu à l’explosion du MET.
J’ignore si c’est vrai, mais j’aime imaginer que Donna Tartt ait eu l’idée de départ pour son roman en contemplant le tableau de Fabritius, à la Haye ou à New-York. Lors de ma visite impromptue au MET, j’avais choisi de ne pas prendre la brochure qui proposait un itinéraire pour découvrir les chefs d’œuvre du musée, mais plutôt de me laisser mener par les tableaux qui attiraient mon regard, sans faire attention à la renommée des peintres. Sur un bout de papier, j’ai noté dix tableaux devant lesquels je me suis attardé plus longtemps. Plusieurs années ont passé depuis cet après-midi. Récemment, j’ai été recherché les photos de ces tableaux – qui illustrent cet article – et creusé l’histoire de certains d’entre eux. Certains liens avec la littérature m’ont amusé.
« Baleiniers (Whalers) » de Turner fait immédiatement penser à « Moby Dick » d’Herman Melville. Pourtant, s’il y a inspiration, elle ne peut avoir été du roman au tableau, puisque Turner le signa vers 1845 tandis que Melville ne publia qu’en 1851 son livre décrivant la poursuite obsessionnelle du cachalot blanc Moby Dick par le capitaine Achab. Les deux tableaux suivants nous présentent deux intérieurs on ne peut plus différents : d’une part, paisible salle à manger hollandaise dans laquelle Vermeer représente « Une jeune fille assoupie » dont on voudrait deviner les rêves et d’autre part un « Intérieur rustique italien » de Fragonard qui nous emmène dans le sous-sol d’une grande demeure romaine où les lingères et autres servantes s’affairent et bavardent entourées pêle-mêle d’enfants, de nouveau-nés et d’animaux.
« La Moisson » ou « Les Moissonneurs » de Pieter Brueghel l’Ancien peint en 1565 est souvent présenté comme le premier paysage moderne : les paysans descendant les gerbes de blé à travers la coupe faite dans le champ donnent l’impression de distance. Comme souvent avec Brueghel, on se régale aussi des détails : la cruche, le panier, le pain, le fromage.
Bien sûr une référence littéraire omniprésente dans la peinture, c’est la Bible. Commençons par « Agar dans le désert » de Camille Corot. L’occasion de se rappeler l’histoire de cette servante d’Abraham à qui il fit un enfant, Ismaël, alors que Sarah, sa femme, était stérile. Après que Sarah miraculeusement tombe enceinte d’Isaac malgré son âge avancé, Agar et son fils sont chassés dans le désert munis d’un peu de pain et d’eau. Dieu leur viendra en aide en leur indiquant un puits, mais je dois avouer que je ne connaissais pas cet envers peu reluisant de l’histoire officielle d’Abraham, Sarah et Isaac.
Une des premières toiles tahitiennes de Paul Gauguin « Ia Orana Maria » ou « Je vous salue Marie » en polynésien transpose l’image de la vierge à l’enfant dans l’univers de la végétation luxuriante, des pagnes aux couleurs chatoyantes et des visages féminins empreints de sérénité des îles du Pacifique.
« La Madeleine Pénitente » de Georges de La Tour et « La Cène d’Emmaüs » de Diego Vélasquez soulignent mon goût pour le clair-obscur et pour les personnages ou scènes des Evangiles où le Christ prend ses suiveurs et ses disciples à contre-pied. Un troisième tableau où règne le clair-obscur est « Le Reniement de Saint-Pierre » par le Caravage. Là encore une scène biblique qui m’a toujours attiré, celle où Pierre, qui sera le premier pape, le précurseur de ceux qui se draperont dans l’infaillibilité pontificale, fait montre d’une humanité et d’une vulnérabilité rassurantes.
« Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois ». Il sortit et pleura amèrement. » (Luc 22, 60:62).
Charles Baudelaire, dans « Les Fleurs du Mal », aborde « Le Reniement de Saint Pierre » sous un tout autre angle. Dans son poème, après avoir décrit le Christ priant au Jardins des Oliviers, souffrant et humilié au Calvaire et se souvenant avec désespoir de ses heures de gloire lors des Rameaux ou chassant les marchands du temple, Baudelaire choisit de déconcerter et choquer son lecteur en concluant :
— Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve;
Puissé-je user du glaive et périr par le glaive!
Saint Pierre a renié Jésus… il a bien fait!
Le dernier des tableaux de mon après-midi au MET était « L’Enterrement à la Glacière » d’Edouard Manet. Et de manière surprenante, il nous ramène à Baudelaire, puisqu’il est acquis que ce tableau inachevé que Manet conserva dans son atelier jusqu’à sa mort, représente l’enterrement du poète auquel le peintre assista, dans les faubourgs ruraux de Paris en 1867. Ils étaient amis puisque Baudelaire dédia un de ses « Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris) » intitulé « La Corde » à Edouard Manet. Un peintre engage un jeune garçon pauvre pour prendre soin de ses pinceaux et de ses couleurs et de temps à autre lui servir de modèle. Un soir qu’il rentre dans son atelier, il découvre le garçon pendu. Après avoir contacté le médecin et la police, le peintre s’en va le cœur lourd annoncer la nouvelle aux parents. Une fois dans l’atelier, la mère le supplie de lui donner la corde du pendu. Le peintre accepte pensant qu’elle veut garder un dernier souvenir de son enfant. Il ouvre les yeux quand le lendemain il reçoit quantité de lettres cherchant à obtenir un morceau de la corde. Une fois encore Baudelaire utilise l’art du contrepied pour choquer ses lecteurs et leur ôter toute illusion sur la nature humaine.